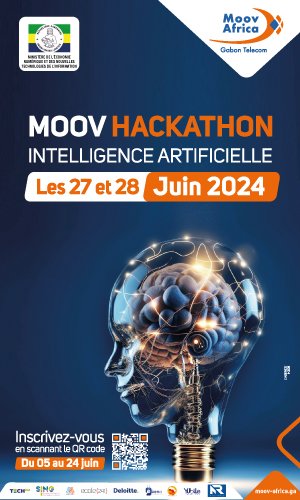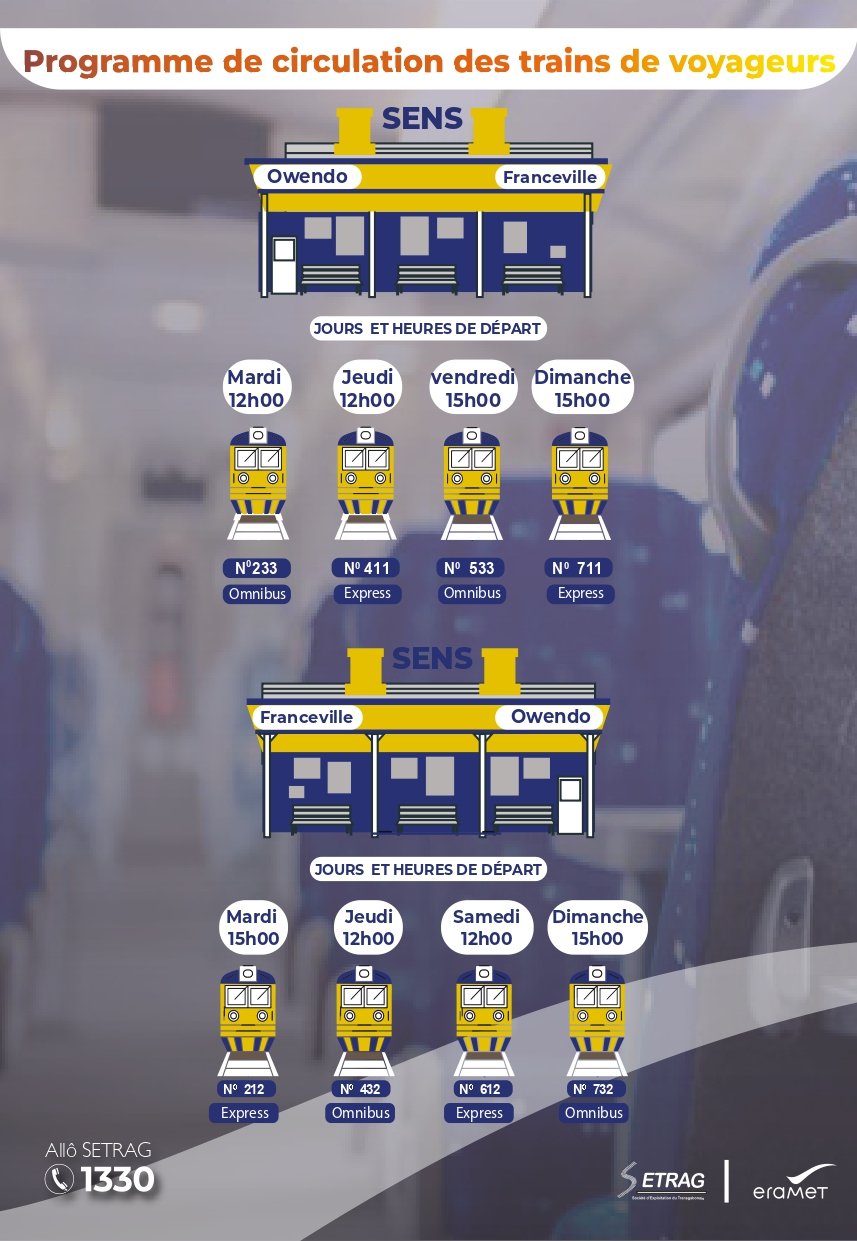Calendrier Historique
16 novembre 1945 : l’Unesco est créée sur les décombres de la guerre

L’Unesco, Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, est née sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Comme l’ONU, dont elle est une agence spécialisée, elle entend, pour ses pères fondateurs, contribuer à la paix dans le monde et à une meilleure entente entre les peuples. « Les guerres naissant dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes qu’il faut élever les défenses de la paix. » Cette devise, qui est la première phrase de son acte constitutif, est un postulat idéaliste qui exprime sa volonté d’agir au niveau des consciences, par l’éducation à la tolérance et au respect des différences et des identités culturelles.
Si la création de l’Unesco s’inscrit dans l’héritage de l’IICI, marqué par une conception élitiste de la culture, elle doit aussi beaucoup à l’influence anglo-saxonne : en effet, Américains et Britanniques, réunis de 1942 à 1945 dans la conférence des ministres alliés de l’éducation (Came) à Londres, développent l’idée que la future organisation doit, pour mieux atteindre son but que ne l’avait fait l’IICI, toucher les masses grâce aux mass media et à une action éducative massive. D’où l’inclusion du « E » dans le sigle de la future institution.
Ainsi la nouvelle organisation qui naît fin 1945 doit beaucoup à des hommes tels que l’Américain Archibald MacLeish, poète et directeur de la bibliothèque du Congrès à Washington (pour qui l’Unesco doit devenir « la conscience morale de l’humanité »), le sénateur américain J. William Fulbright, créateur des bourses Fulbright, ou à son compatriote William Carr, de la National Education Association (NEA). À la première conférence générale de l’Unesco, l’année suivante, sont présents des grands noms de la culture et de la politique mondiale comme Léon Blum ou Paul Rivet, directeur du musée de l’Homme, ainsi que des artistes comme Louis Jouvet.
L’organisation qui naît en 1945 ne part pas de rien : elle succède à l’Institut international de coopération intellectuelle (IICI), son précurseur, qui avait fonctionné dans l’entre-deux-guerres sous l’égide de la Société des nations (SDN). Cet institut se caractérisait par la volonté de faire dialoguer les intellectuels, par l’aspiration à créer une « société des esprits » internationale, selon les mots de Paul Valéry, qui y avait contribué.
Son premier directeur général sera le Britannique Julian Huxley, zoologue de renom, frère de l’écrivain Aldous Huxley. Son mandat (1946-1948) coïncide avec une période effervescente et créatrice pour l’institution, qui collabore avec de nombreux savants et intellectuels et lance des projets tous azimuts : des projets de protection de l’environnement, de manière pionnière à une époque où la communauté internationale se préoccupait encore peu d’écologie, et des projets d’« éducation de base » comme à Haïti.
Par la suite, dans les années 1958 à 1974, l’Unesco, installée dans le remarquable bâtiment en Y construit place de Fontenoy à Paris, connaîtra son heure de gloire sous la direction du Français René Maheu, charismatique directeur général qui impose l’organisation comme fer de lance de l’aide à l’alphabétisation en Afrique, mais aussi de protection du patrimoine mondial : après avoir sauvé les temples d’Abou Simbel en 1968, l’Unesco crée en 1972 la liste du patrimoine mondial, appelée à un beau succès car elle comporte aujourd’hui plus de 1 000 sites et car elle est devenue un label de prestige.
Au cours de ces années, l’Unesco connaît un virage conceptuel : alors que lors de sa création son objectif affiché était de contribuer à mettre en place une « culture mondiale unique », censée aider à la compréhension internationale des peuples, peu à peu, sous l’effet de la mondialisation en cours et de l’uniformisation accélérée des cultures et des modes de vie qu’elle entraîne, l’organisation change de cap et se consacre désormais plutôt à la préservation des cultures minoritaires et menacées.
C’est le sens de la « convention sur la diversité culturelle » adoptée en 2005 et entrée en vigueur en 2007. C’est un autre des grands succès de l’organisation que ce texte normatif, qui s’oppose à la logique marchande de l’OMC et universalise la notion française d’« exception culturelle ». Ce texte a été adopté grâce à l’action conjuguée de la France et du Canada, et malgré l’opposition des États-Unis, qui ont refusé de le signer.
Les États-Unis cultivent en effet une attitude critique envers l’Unesco, s’étant retirés de l’organisation de 1984 à 2003 et ayant récemment, depuis 2012, retiré leur financement à l’institution pour protester contre la reconnaissance par l’Unesco de la Palestine comme État membre. Ces éléments montrent en tout cas que l’Unesco, organisation culturelle par excellence, est aussi une organisation éminemment politique.
Calendrier Historique
18 juillet 2023: Célébration de la journée internationale Nelson MANDELA

Le 18 juillet est le 199e jour de l’année du calendrier grégorien, 200e lorsqu’elle est bissextile, il en reste ensuite 166e.
La Journée internationale Nelson Mandela (en anglais : Nelson Mandela Day) fut proclamée par l’UNESCO le 10 novembre 2009 et célébrée le 18 juillet de chaque année afin de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d’Afrique du Sud, à « la promotion d’une culture de paix ».
Durant cette journée, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement soixante-sept minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité, en mémoire des soixante-sept années que Mandela a vouées à sa lutte pour la justice sociale l’égalité, réconciliation et diversité culturelle.
Le 18 juillet correspond à la date d’anniversaire de Nelson Mandela et le 18 juillet 2010, la première célébration, correspond à ses 92 ans.
Calendrier Historique
30 juin 2023: fête de l’indépendance de la RDC

Le 30 juin est le 181e jour de l’année du calendrier grégorien, 182e lorsqu’elle est bissextile, il en reste ensuite 184e.
Le 30 juin 1960 le Congo arrache son indépendance à la Belgique. Patrice Lumumba joue un rôle capital dans cette émancipation. Chargée d’espoir, l’indépendance bascule le pays dans le chaos : le Katanga puis le Kasaï font sécession ; craignant pour leur vie, les Belges s’enfuient ; la Belgique puis les Nations unies envoient des troupes ; les gouvernements congolais se succèdent après l’assassinat de Lumumba en janvier 1961.
En 1965, Mobutu, chef d’état major de l’armée, renverse par un coup d’État le président Joseph Kasa-Vubu. Le Congo retrouve une certaine stabilité au prix d’un régime autoritaire. Il devient le Zaïre. Mobutu se maintient au pouvoir pendant trente deux ans. En 1997, l’avance de l’AFDL avec M’zée Laurent Désiré Kabila, une force armée rebelle, l’oblige à fuir Kinshasa. Le régime tombe, affaibli par la crise économique, discrédité par la corruption, et abandonné par les puissances occidentales.
Le porte-parole de l’AFDL, Laurent-Désiré Kabila, se proclame chef d’État en mai 1997. Le pays change encore une fois de nom devenant la république démocratique du Congo. Kabila conduit le pays d’une manière aussi autocratique que son prédécesseur et le plonge dans la guerre (Deuxième guerre du Congo). Depuis l’assassinat de Kabila (2001) et la fin du conflit, le Congo est entré dans une phase de démocratisation, marquée notamment par la tenue d’élections libres en 2006, 2011 et 2018. Le président actuel est Félix Tshisekedi, fils d’Étienne Tshisekedi, succédant à Joseph Kabila (fils de Laurent Kabila) depuis janvier 2019. Cette succession marque pour la première fois l’alternance pacifique en RDC.
Calendrier Historique
26 juin 1960: Célébration de la fête de l’indépendance de Madagascar

Le 26 juin est le 177e jour de l’année du calendrier grégorien, 178e lorsqu’elle est bissextile, il en reste ensuite 188e.
L’indépendance de Madagascar est proclamée le 26 juin 1960 à l’issue d’un processus négocié entre l’élite politique malgache et le gouvernement français, qui avait fait de l’île une colonie 65 ans plus tôt.
Ce processus débute après l’insurrection malgache de 1947, violemment réprimée par le gouvernement français qui refusait toute autonomisation croissante de ses colonies.
Dans les années 1950, la capitale Tananarive se retrouve au centre d’une lutte entre Malgaches autonomistes et indépendantistes, les deux groupes fondant différents partis. À la fin de la décennie, les territoires français d’Afrique sub-saharienne acquièrent une autonomie croissante, en particulier lorsqu’ils entrent en 1958 dans la Communauté française fondée par Charles de Gaulle lors de la mise en place de la Cinquième République.
Comme les autres membres de cette fédération, Madagascar décide cependant rapidement d’accéder à l’indépendance formelle. Les premiers ministres malgache Philibert Tsiranana et français Michel Debré signent l’accord d’indépendance le 2 avril 1960 et celle-ci est proclamée le 26 juin 1960 jour de la fête nationale malgache. Les deux États restent très liés dans les années qui suivent. Madagascar intègre ensuite l’ensemble des organisations internationales.